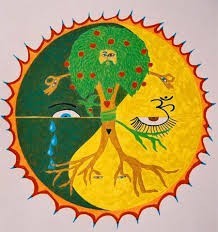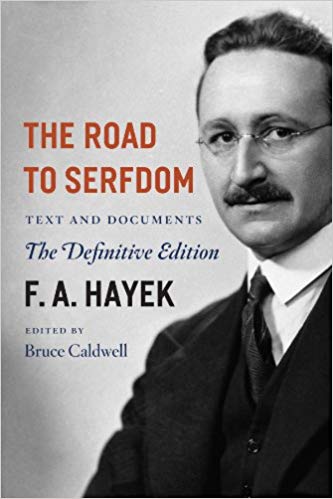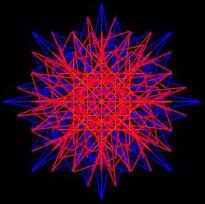Si la question de l’achat de terres à l’étranger de la part d’États, d’entreprises ou de fonds d’investissements défraye régulièrement la chronique, l’agriculture montre aussi qu’elle peut être une activité sur laquelle miser. Qui sont ces individus qui investissent leur argent dans l’agriculture plutôt qu’en bourse, et pourquoi ?
Hubert Cochet, professeur d’agriculture comparée à AgroParisTech, n’y va pas par quatre chemins : « L’achat ou la prise de contrôle de terres à l’étranger n’est pas une nouveauté en soi, l’époque coloniale est là pour nous le rappeler, mais ce phénomène se développe rapidement depuis la crise des prix alimentaires de 2007-2008. Désormais ce sont les États et les investisseurs privés qui se lancent à une allure considérable sur ce créneau. » Il n’est pas le seul à s’intéresser à ce phénomène. Et pour cause, il ne s’agit pas de quelques opérations anodines, mais bien d’une tendance mondiale de fond : « Entre 15 et 20 millions d’hectares ont été achetés ou sont sur le point de l’être, ce qui représente 25 % de la totalité des terres agricoles d’Europe », selon l’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (Ifri).

Quelques cas médiatisés
Difficile, malgré tout de chiffrer précisément un phénomène qui par essence cultive la discrétion. Schématiquement, deux grands cas de figure coexistent. Tout d’abord et c’est le cas le plus ancien, certains États et quelques grandes multinationales partent à la recherche de terres. C’est le cas de la Chine qui « loue des terres pour sa propre production depuis dix ans à Cuba et à Mexico et continue activement ses recherches », précise l’Ifri. S’ajoutent à cette liste l’Inde, mais aussi les États pétroliers qui ont peu de terres agricoles et beaucoup d’argent. Ces investisseurs suscitent même depuis quelque temps une vive polémique, accusés d’acheter ou de louer des terres dans des pays pauvres, sans se soucier des populations locales (lire avis d’expert). Dans l’ombre de ces mastodontes, une nouvelle catégorie d’acteurs émerge sur la scène de l’investissement alimentaire internationale : les « petits privés », et parmi eux, les fonds d’investissement, les family office ou dans une moindre mesure des particuliers dont certains issus du monde agricole. En France, les exemples médiatisés sont rares mais le plus visible est celui d’AgroGeneration. Détenue à 50 % par son fondateur, Charles Beigbeder, et par d’autres actionnaires dont Champagne Céréales, cet investisseur né en 2007 s’est développé en Ukraine. « Des céréaliers du grand bassin parisien, de la plaine de Caen et des plateaux Lorrains ont, à titre individuel, tenté l’aventure sur des surfaces allant de 1 000 à 3 000 hectares notamment en Ukraine », ajoute Hubert Cochet. Jean-François Isambert, agriculteur, secrétaire général de l’AGPB et membre de plusieurs conseils d’administration de groupes céréaliers, a tenté l’aventure il y a quelques années, en exploitant plus de 1 000 hectares en Roumanie. « Il semble que des coopératives agricoles de l’ouest de la France effectuent depuis quelques années des voyages prospectifs en Europe de l’Est », précise Christian Bouquet, professeur de géographie politique et du développement à l’Université Bordeaux 3. L’intérêt est en tout cas affiché, même si les réalisations sont plus rares. D’où l’émergence d’acteurs spécialisés dans le conseil et l’implantation, comme Beten International, créé par Jean Roche, un exploitant de céréales et d’oléagineux installé en Ukraine à l’époque soviétique. Agritel, une société spécialisée dans la gestion du risque de prix dans les filières agricoles et agroalimentaires, propose également des formations ciblées notamment sur « les secteurs agricoles et agro-industriels en Ukraine : opportunités et menaces ». Objectif affiché : « Se projeter dans une position d’investisseur potentiel ».
Un placement censé…
En plein développement, l’investissement agricole à l’étranger peut-il être rentable ? Cette question, François Mollat du Jourdin, qui conseille les grandes fortunes, se la pose : « C’est un thème d’investissement que j’étudie depuis deux ou trois ans, avance le président de Financière MJ Family office. J’ai notamment pu regarder ce sujet de près à l’occasion d’un voyage en Russie en 2008. Ce placement peut s’apparenter à l’achat d’immeubles ou de forêts. C’est un retour à la terre, aux actifs réels. » La pratique est déjà courante dans les vignobles, de nombreux viticulteurs français ayant investi les terres du nouveau monde, en Argentine ou en Afrique du Sud, mais aussi celles d’Europe de l’Est. Comme dans la viticulture, les arguments à long terme en faveur de l’investissement céréalier international sont pour la plupart classiques. Les terres disponibles sont abondantes et de très bonne qualité, notamment dans certaines régions agricoles des pays de l’Est : « Les paysages sont plats, le sol a des potentialités considérables, les parcelles de l’ordre de 100 à 200 hectares sont attrayantes, peu de travaux en termes d’aménagement foncier sont à prévoir », résume Hubert Cochet. Le coût d’accès reste faible : « En termes de bail commercial, les prix sont de trois à cinq fois moins cher que ceux pratiqués dans le bassin parisien. Quant à la main-d’oeuvre qualifiée, elle est dix fois moins chère. À titre d’exemple, un chauffeur de tracteur est rémunéré 200 euros brut maximum par mois », illustre Hubert Cochet. Mais un autre argument, plus fort encore, milite pour l’internationalisation des agriculteurs français : l’explosion de la demande mondiale. La consommation de céréales ne devrait pas cesser de croître, tirée par l’augmentation de la population mondiale, les nouvelles habitudes alimentaires dans les pays émergents, ou l’explosion des bio-carburants.

… mais risqué
Reste qu’à ce jour, ce type d’investissement est limité à quelques « happy few ». « Ce type d’opération intéresse des clients aux patrimoines importants car il s’agit d’un élément diversifiant, au même titre que le private equity, par exemple », estime François Mollat du Jourdin. Le placement, de surcroît, reste risqué, même en Europe de l’Est. Charles Vilgrain, directeur général d’AgroGeneration, le confirme : « L’aventure dans l’ex URSS n’est pas évidente, la langue, le mode de pensée, l’approche agricole et l’environnement sont très éloignés de chez nous. Si bien que beaucoup d’investisseurs non préparés perdent de l’argent. » Pour François Mollat du Jourdin, pas de doute : « Il faut se faire aider, c’est-à-dire trouver les bons canaux d’investissement : création d’un fond d’investissement pour acheter et exploiter des terres agricoles, partenariat avec une firme locale… J’ai eu l’occasion d’étudier des propositions d’acteurs de grande qualité, intervenant en Amérique du Sud (Uruguay en particulier). » Le risque politique, le manque d’infrastructures, la corruption, l’ambiguïté quant à la propriété des terres dans de nombreux pays pauvres sont autant d’exemples qui poussent à la prudence.
Caroline Dupuy